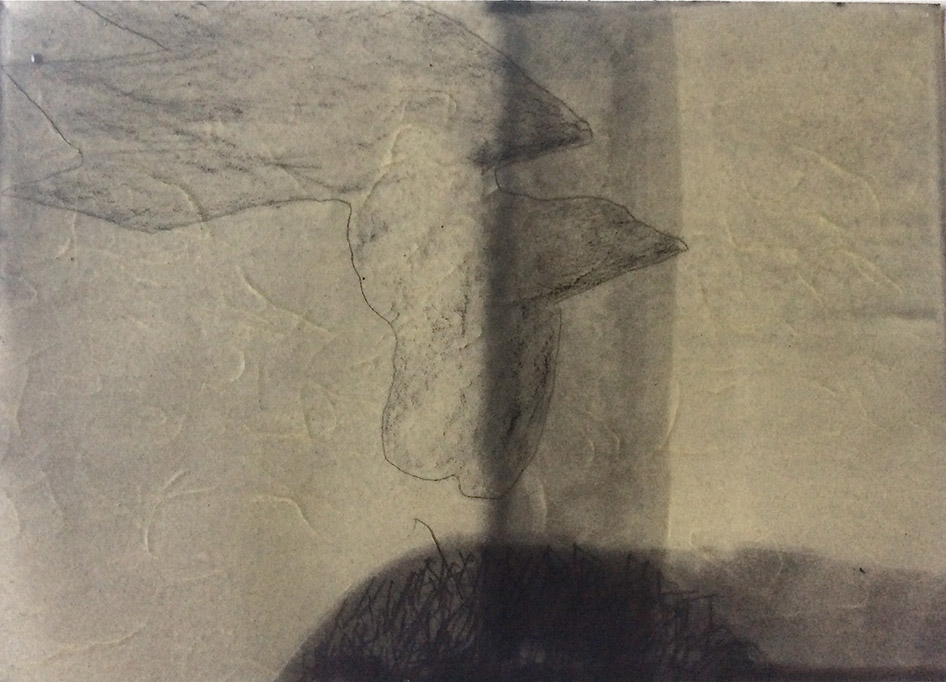La Galerie Laurence Bernard a le plaisir de présenter la première exposition monographique d’Angelika Markul en Suisse : Excavations of the Future. Ses pratiques de superposition de temps exogènes, d’état des lieux avant ou après extinction, de coexistence d’un informe organique et d’une angulosité des systèmes de monstration, y rencontrent pour la première fois une formulation de figure humaine.
L’artiste propose un parcours entre deux « chambres » inspirées par l’architecture cérémonielle mésoaméricaine – celle de Teotihuacan ou Huaca en particulier. Plus qu’une réplique de formes extérieures, ce sont les symboles du soleil puis de la lune, une ordonnance des espaces réglée sur l’équilibre cosmique, et la disposition d’objets comme extraits d’une fouille, qui évoquent ces sites. La dimension religieuse s’efface au profit d’une approche quasi clinique, combinant étroitement deux strates temporelles : celle du déploiement d’une civilisation, et celle de sa fouille. La superposition du rite sous son aspect formel et de son analyse revêt l’apparence d’une mise à jour d’éléments disparates tenus pour seules traces d’une entité éteinte. Si l’on qualifie de « seuils » ces temps exogènes réunis en un seul lieu, résonnent les analyses de Michel Foucault dans L’archéologie du savoir : « La répartition dans le temps de ces différents seuils, leur succession, leur décalage, leur éventuelle coïncidence, la manière dont ils peuvent se commander ou s’impliquer les uns les autres, les conditions dans lesquelles, tour à tour, ils s’instaurent, constituent pour l’archéologie un de ces domaines majeurs d’exploration. » Le titre de l’ensemble rend la datation de cette unité d’étude d’autant plus ambiguë : cette civilisation en dissection serait-elle la nôtre ? Il y a un penchant universalisant dans ce dispositif, où aucun élément n’est assez altéré ni assez intact pour n’être que d’hier ou d’aujourd’hui.
L’espace bipartite accueille, outre l’image d’une activité de prélèvement, un ensemble de questions existentielles, et les confronte, à nouveau, à leur traitement par des protocoles théoriques. L’on décèle, à travers des formes informes, la question du devenir organique. L’accumulation dans la première salle de sculptures noires, ni humaines, ni animales, ni végétales, de pures formes organiques en « état de viande », soumet au regard le soupçon de la fin. Des têtes osseuses, comme momifiées, évoquent une perte d’harmonie formelle, c’est-à-dire, dans un sens platonicien, de la possibilité de la beauté. Angelika Markul refuse à un accessoire rituel – un masque funéraire, couvert de turquoises, de coquillages – cette charge d’harmonisation ou de pseudo-mémoire. S’attachant – s’attaquant – pour la première fois au motif de la figure, elle la rend à son devenir, la met en vitrine, comme un objet d’examen après coup.
Ainsi en est-il des autres sculptures : à l’image du constat d’accumulation d’objets que fait une personne au cours de sa vie, les fouilles archéologiques révèlent un ensemble de fragments dépourvus de sens a priori, et nécessitant des outils spécifiques, un mode opératoire codifié pour les interpréter, en déceler l’usage, les raisons d’être, et de rester. La question demeurant : que nous reste-t-il de l’autre – civilisation, continent, culture, « seuil » ? Si l’on trouve des objets dans les chambres funéraires de Teotihuacan, chargés d’accompagner le mort dans un parcours raconté dans les grands mythes non des origines mais de l’au-delà, il ne reste d’un corps contemporain que des objets hors sol, non préservés avec le défunt, lui-même sujet à des traitements destructifs. Les rites de vie éternelle, peut-être suggérés par la découverte d’une importante quantité de mercure sous la Pyramide du Serpent à Plumes de Teotihuacan, transcrivent un au-delà rêvé, sur lequel veillent la lune et le soleil – à l’instar des interprétations aztèques du site au XVIème siècle, époque à laquelle Teotihuacan est rebaptisée « le lieu où les dieux sont créés ».
Les prélèvements de sol de la seconde salle, de tonalité bleutée sous les auspices de la lune, relèvent d’un aspect différent de la fouille. La cire blanche préserve la douceur spectrale de cette scène plus « documentaire », où des cadres à la disposition précise composent un sol découpé en aires égales. Le système de monstration vertical, le silence clinique des cadres blancs, échantillonnent ce sol à la manière d’un relevé scientifique. Le passage de formes organiques à des couches telluriques arase le facteur corporel, rappelle le rapport récurrent d’Angelika Markul aux faits de nature, mouvements géologiques, catastrophes passées et en puissance, expliquant peut-être l’extinction de la première salle.
Plutôt qu’un lieu nécropole, le site comme l’exposition évoquent des transformations, que la nature elle-même prend en charge, à la faveur du facteur temporel. Si l’artiste s’assigne le droit de manipulation des strates de terre et de temps, elle révèle et confronte les grandes forces à l’œuvre par la main de l’homme – l’architecture tendant vers le ciel, le lieu déifié, le cours de mercure souterrain, surface spéculaire et renversement de surface et tréfonds – et par la nature – décomposition, perte de la mémoire et des traces d’interprétation des signes civilisationnels. La persistance rétinienne créée par la récurrence des néons circulaires est une allusion ambiguë à une énergie transformée – « rien ne se crée, ni dans les opérations de l’art, ni dans celles de la nature, et l’on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l’opération ; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu’il n’y a que des changements, des modifications» (Lavoisier, Traité élémentaire de chimie, 178, p. 101) – ou à une lumière astrale déifiée par des moyens techniques. Il y est question de trajet, du soleil à la lune, trajet aller-retour, de rites, de mises à jour littérales.
– Audrey Teichmann